Que Besançon baptise une rue au nom de Colette Dondaine !
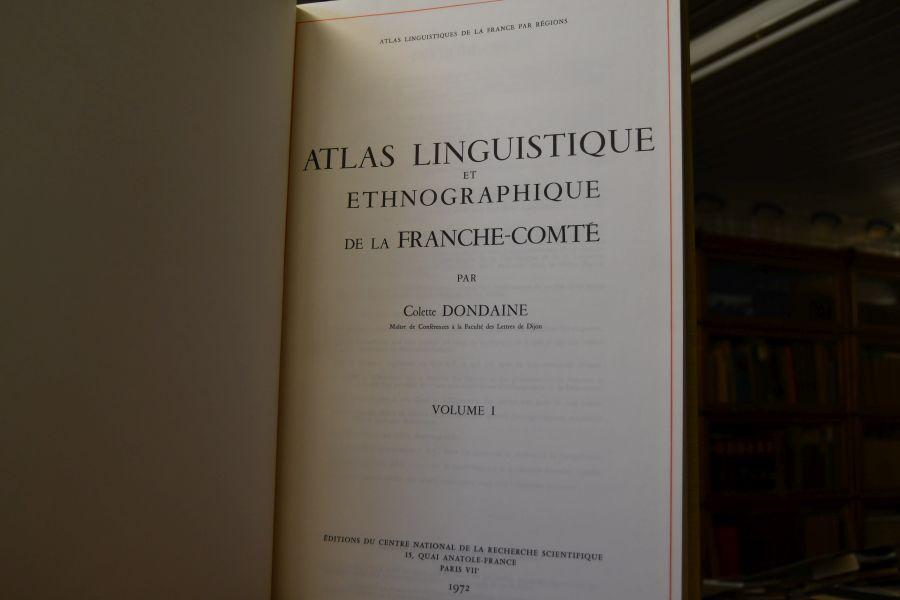
Promenez-vous dans les rues de Besançon, vous y verrez des statues, des parcs, et surtout des avenues, des rues et des places dont les noms célèbrent la mémoire de dizaines d’hommes et de femmes. Beaucoup ont contribué de près ou de loin à l’histoire de la capitale comtoise ; d’autres n’y ont jamais mis un pied et ne savaient peut-être même pas la placer sur une carte… Mais à l’heure de la féminisation des noms de rue, une grande linguiste est encore aujourd’hui injustement oubliée : Colette Dondaine, née Filloz le 9 mars 1921. Cette quinzième comtoiserie lui est dédiée, et c’est elle-même qui parle le mieux du début de sa vie alors qu’elle n’a que dix-huit ans :
Je suis née à Breuchotte (Haute-Saône) à neuf kilomètres de Luxeuil. Mon père originaire d’Ehuns. Ma mère originaire de Fontaine. Aïeux du côté paternel cultivateurs à Ehuns ou Baudoncourt (commune situé trois kilomètres d’Ehuns). Aïeux du côté maternel, cultivateurs à Fontaine, Aillevillers ou Ormoiche. On a toujours parlé patois dans les deux familles. Mon père n’a cessé de parler patois que vers l’âge de dix-huit ans, il le connaît encore assez bien. Jusqu’à l’âge de douze ans, j’ai passé chaque dimanche et une grande partie de mes vacances chez les grands-parents maternels, dans un milieu patoisant. Je passe maintenant toutes les vacances à Raddon, où mes parents sont instituteurs et où j’ai souvent l’occasion d’entendre les paysans s’exprimer en patois. Je comprends assez bien le patois et je le parle tant bien que mal.
En 1939, alors qu’elle est étudiante à Paris sous la Direction du linguiste et philologue français Charles Bruneau, elle écrit cette lettre à une correspondante : Chère Demoiselle. Me voici enfin en vacances ; je suis reçue définitivement en philologie avec 6 pts ½ d’avance, ce qui est tout à fait honorable. Je suis rentrée à Raddon mardi, après avoir vu Bruneau. Mon sujet de diplôme est maintenant définitif : il s’agit de préciser la frontière linguistique entre les Vosges et la Haute-Saône. Je dois faire de nombreuses recherches sur les patois de la région, en allant surtout vers le nord. Voilà donc Papa forcé de laisser son jardin pendant les vacances pour me conduire de village en village baragouiner en patois avec les paysans. Vous voyez la scène !
Et quelle scène ! Son enquête porte alors sur neuf localités du département des Vosges et quarante-quatre localités du département de la Haute-Saône. La jeune Colette rapporte alors que le franc-comtois a « complétement disparu » du centre de Champagney, est « en pleine décadence » à Ronchamp, mais est « bien vivant » à Saint-Germain ou Vy-les-Lure. Cette première enquête est aussi un véritable trésor ethnologique tant l’environnement des villages et des fermes est analysé ; témoignage précieux de la vie aux confins de la Franche-Comté et de la Lorraine, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale.
En 1940, elle soutient donc à la Sorbonne un diplôme d’études supérieurs officiellement intitulé « Recherche sur une frontière dialectale entre les Vosges et la Haute-Saône ». Malheureusement, le tapuscrit original est perdu lors du retour précipité de notre linguiste à Raddon ; heureusement, elle pris soin de conserver ses brouillons : un modeste cahier d’écolier, des cartes manuscrites, et 18 tableaux de données réalisés avec des feuilles de cahier collées ensemble. C’est à cette époque qu’elle rencontre son futur mari, Lucien Dondaine, étudiant franc-comtois à Paris, comme elle. Lui est originaire des environs de Vesoul.
Devenue alors Colette Dondaine, elle est agrégée de grammaire en 1947 et rejoint Besançon avec son mari où elle est nommée professeur au Lycée Louis Pasteur. En 1959, elle devient directrice du collège de Montjoux et profite alors d’une carrière administrative. Mais le destin la rattrape lorsqu’elle est contactée par un professeur de l’Université de Dijon, Robert Loriot. Ce dernier, ayant pris connaissance de son enquête de 1939, souhaite alors une enquête générale en Franche-Comté pour compléter un Atlas linguistique bourguignon, lui-même partie d’un Atlas linguistique de la France. En 1960, elle rentre alors dans l’enseignement supérieur à l’Université de Dijon et débute une enquête qui durera une décennie. Une décennie à tracer des isoglosses et à étudier des diphtongues et des rhotacismes ; une décennie de route où, pendant les vacances, en caravane ou camping-car, avec son mari et ses deux filles, elle parcourt toute la Franche-Comté sur près de quatre-vingt-dix points d’étude avec des incursions en Côte d’Or, en Haute-Marne, dans les Vosges, et bien sûr en Suisse, notamment à Sainte-Ursanne. Enfin, elle soutient sa thèse « Les parlers comtois d’oïl, étude phonétique » à Strasbourg en 1969.
Mais son enquête de 1939 et sa thèse de 1969 n’étaient que les prémices de son chef-d’œuvre paru en quatre volumes, respectivement en 1972, 1978, 1984 et 1991 aux éditions du CNRS : L’Atlas linguistique et ethnographique de la Franche-Comté. C’est à travers ces quatre livres (dont le dernier est signé par son mari), qu’elle développe la théorie selon laquelle la Comté eût été un temps entièrement arpitanophone. D’après elle, l’arpitan aurait été parlé jusqu’aux pieds des Vosges avant de reculer progressivement vers le sud au profit de la formation de la langue franc-comtoise durant le Moyen âge. Enfin, il se serait définitivement fixé entre le XIVe et le XVe siècle le long de la vallée de la Loue, frontière naturelle devenue linguistique.
Scientifique pleine de justesse, elle porte alors un regard éclairé sur la situation linguistique originale de la Franche-Comté : « Il a fallu que le français n’eût gagné la partie que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le patois ayant acquis alors, du même coup, par contraste, une valeur pittoresque. »
Pittoresque comme sa réédition-traduction des « Noëls au patois de Besançon du XVIIe et XVIIIe siècle » en 1997. Son amitié avec l’abbé Jean Garneret permet alors de perpétuer la mémoire des Bousbots et la tradition linguistique de Besançon. Enfin, elle publie Le Trésor étymologique des mots de la Franche-Comté en 2002, puis une réédition-traduction de La Jaquemardade de Jean-Louis Bizot en 2009, dans les pages de la revue Barbizier.
Chevalier de la légion d’honneur, membre de l’Académie des Sciences, des Arts et des Lettres de Besançon, elle est aussi, dans un monde plus modeste et populaire, sympathisante de l’Union des Patoisants en Langue Romane de Belfort-Montbéliard. En 2006, Valérie Bron, autre grande plume comtophone venue du Territoire de Belfort, décrit une conférence de Colette Dondaine à Vercel : « Une voix fluette amplifiée par le micro avait capté tout l’auditoire. Cette voix émanait d’une petite dame que certains de nos intellectuels patoisants connaissaient par ses ouvrages, quand d’autres la découvraient. » Plus tard, Valérie Bron reprend : « Nos remerciements vont particulièrement à Madame Dondaine qui, par sa présence, l’intérêt qu’elle porte à l’étude du patois, nous a confortés dans notre attachement, notre fidélité à ce que fut le langage de nos lointains aïeux. Langage injustement méprisé comme étant l’expression des classes inférieures de la société d’antan. »
Linguiste spécialisée en langues romanes et dialectologie, elle reste active dans ce domaine jusqu’à la fin de sa vie. Colette Dondaine, née Filloz, s’éteint à Besançon le 23 octobre 2012 à l’âge de quatre-vingt-onze ans. Elle est depuis inhumée près de son mari Lucien (décédé en 2005) à Fontaine-lès-Luxeuil. Considérée comme la plus grande linguiste franc-comtoise et comtophone du XXe et début XXIe siècle, Colette Dondaine laisse un héritage hors du commun de par la précision de ses recherches dédiées à la compréhension des langues de la Franche-Comté.
Depuis 2020, la majorité du conseil municipal de Besançon voue une partie de son programme à féminiser l’espace public de la ville. Si jusque là, personne ne semblait avoir pensé à elle, autant dire qu’avec cette comtoiserie, notre linguiste est désormais une sérieuse prétendante à tant d’honneur.
Illustration d’en-tête : Atlas Linguistique et Ethnographique de la Franche-Comte. Volume 1. – Göppinger Antiquariat.
